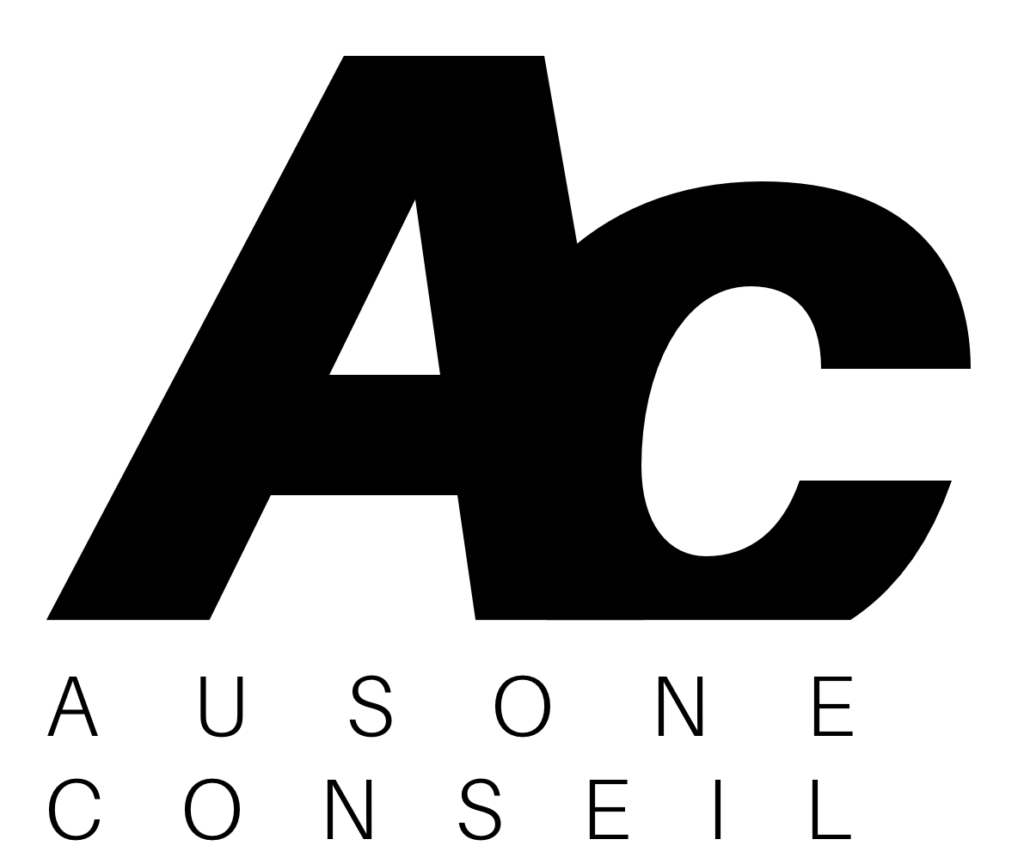Le sport face à l’urgence écologique, l’athlétisme à ses solutions.
En 2024, le monde du sport a franchi un cap symbolique. Alors que les records tombent et que les athlètes repoussent sans cesse les limites du possible, une autre course, bien plus silencieuse mais tout aussi cruciale, s’engage : celle de la durabilité. Avec le lancement officiel de son Athletics for a Better World Standard (ABW), World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, a tenté de placer sa discipline en tête de peloton sur les enjeux environnementaux et sociaux. C’est pourquoi, depuis 2020, World Athletics applique une stratégie mondiale de durabilité visant à intégrer des pratiques responsables dans tous ses événements, qu’ils soient organisés directement ou soutenus. Cette stratégie repose sur six piliers et s’appuie sur deux outils principaux : le Sustainable Event Management System (SEMS), qui propose des recommandations de bonnes pratiques dans 15 domaines liés à la planification et à la gestion d’événements, et le Standard Athletics for a Better World, qui permet d’évaluer, mesurer et certifier le niveau de durabilité atteint par chaque compétition.
La norme Athletics for a Better World (ABW) couvre 55 domaines d’action liés à l’organisation d’événements sportifs. Elle traite aussi bien des aspects environnementaux, comme l’approvisionnement responsable, la gestion des déchets, de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau, ou encore la planification des déplacements et de l’hébergement, que des enjeux sociaux, tels que la diversité, l’accessibilité, l’inclusion, la santé, la sécurité et le bien-être des participants et bénévoles. La norme insiste également sur l’implication des parties prenantes clés (partenaires, villes hôtes, athlètes) dans la démarche durable et fournit des lignes directrices pour assurer le suivi, le reporting et la communication des résultats et des ambitions des organisateurs. En juillet dernier, le rapport de l’année 2024 a été publié par le comité, l’occasion pour nous de l’analyser et de comprendre si les démarches entreprises sont réellement efficaces ou relèvent d’une nouvelle forme de greenwashing, qui ne responsabilise pas réellement les événements.
ABW : une norme pionnière dans le paysage sportif ?
Lancé en 2020 et déployé en 2024, le standard ABW s’inscrit dans la lignée des engagements pris par World Athletics pour lutter contre le changement climatique, la pollution et les inégalités. Son objectif ? Évaluer, mesurer et certifier la durabilité des quelque 500 événements labellisés par la fédération, répartis dans plus de 80 pays. Contrairement à d’autres fédérations (comme la FIFA ou le CIO), World Athletics a choisi une approche concrète, structurée autour de 6 piliers : leadership en durabilité (stratégie, communication, innovation), production et consommation durables (achats responsables, gestion des déchets), climat et carbone (réduction des émissions, énergies renouvelables), environnement local et qualité de l’air (biodiversité, pollution), égalité globale (accès au sport, bénéfices locaux) et diversité, accessibilité et bien-être (inclusion, santé des athlètes). Chacun de ces piliers est décliné en 55 actions concrètes, notées pour attribuer une certification (Bronze, Argent, Or, Platine).
En 2024, 102 événements (soit 20 % du total) ont soumis un rapport de durabilité. Parmi eux, deux seulement ont reçu une certification Platine (Championnats du Monde en salle à Glasgow, Bislett Games d’Oslo), deux autres ont décroché une certification Or, puis 4 l’Argent et 5 le Bronze. Ainsi, 43 % des événements évalués ont atteint un niveau de certification. Parmi les exemples les plus marquants, on retrouve la Weltklasse à Zurich, où 90 % des spectateurs sont arrivés en transports en commun et où la restauration était 100 % locale et végétarienne.
Mais derrière ces succès, des ombres persistent, à commencer par le fait que seuls 19 % des événements utilisent des énergies renouvelables. C’est bien trop peu quand on sait que lors de l’organisation d’un événement sportif, la quantité d’énergie utilisée est pharaonique, représentant souvent le premier poste de pollution. La statistique la plus dommageable reste que 45 % des organisateurs estiment manquer de temps et de ressources pour appliquer pleinement la norme, ce qui démontre la faiblesse de l’ABW, qui reste, semble-t-il, trop théorique et à la merci de la volonté des organisateurs.
ABW : un outil de responsabilisation efficace ?
Pour qu’une norme soit efficace, elle doit contraindre, inciter et accompagner. ABW mise sur trois leviers.
Premièrement, l’obligation progressive, qui veut qu’à compter de 2027, les critères ABW deviennent contractuels pour les World Athletics Series (Championnats du Monde, Diamond League, etc.), obligeant donc au respect de ces derniers. Plus ambitieux encore, il est prévu que les événements non conformes aux critères ABW risquent la perte de leur labellisation, voire de leurs subventions.
Deuxièmement, la transparence et la reconnaissance sont vouées à devenir primordiales. Le rapport de l’année 2024 montre que seuls 42 % des événements certifiés publient un rapport public détaillant leurs actions. Le comité World Athletics veut une politique d’honnêteté en favorisant la publication d’un rapport témoignant des efforts écologiques entrepris par les événements. De plus, les certifications Platine/Or sont mises en avant dans les communications de World Athletics, offrant une visibilité médiatique accrue. Cette reconnaissance doit pousser les événements à bien faire pour jouir d’une bonne image et gagner en popularité à tous points de vue.
Troisièmement, l’accompagnement est mis au premier plan de l’action. Pour assurer la qualité et la facilité de la mise en place des normes ABW, webinaires, ateliers et guides sont proposés aux organisateurs. Par ailleurs, une plateforme collaborative est en cours de développement pour partager les innovations (ex. : compostage à Lima, ruches urbaines en Allemagne).
Malgré ces avancées, plusieurs freins majeurs entravent une responsabilisation totale. Tout d’abord, le fossé entre grands et petits événements pénalise ces derniers, faute de moyens et de visibilité. Les grands meetings (Diamond League, Championnats du Monde) peuvent se permettre d’embaucher des consultants RSE ou d’investir dans des infrastructures durables, alors que les petits événements locaux (marathons régionaux, meetings scolaires) peinent à suivre le rythme imposé pour parvenir à de bons résultats (7 % seulement ont recruté un stagiaire dédié et 37 % ont ajouté la durabilité aux tâches existantes, sans budget supplémentaire). Ces revendications sont illustrées par les propos d’un organisateur de meeting en Afrique de l’Est (anonyme) : « Nous voulons faire les choses bien, mais avec un budget de 50 000 €, comment rivaliser avec Zurich ou Doha ? »
Mais l’un des autres grands obstacles reste le défi de la collecte de données. Dans le rapport, on apprend que 60 % des organisateurs épinglent la difficulté à obtenir des preuves (ex. : émissions des fournisseurs, traçabilité des déchets) et que donc les émissions Scope 3 (déplacements des spectateurs, production des équipements) restent peu mesurées. Ces problématiques engagent la véracité des résultats obtenus et prouvent la difficulté à démontrer l’efficacité des mesures mises en place.
Face à ces politiques, qu’en pensent les principaux concernés ?
En premier lieu, les organisateurs oscillent entre innovation et découragement. À Xiamen (Chine), le marathon a obtenu l’Argent grâce à des opérations de nettoyage et de plogging, mais l’empreinte carbone reste impossible à mesurer correctement, ce qui démontre l’ambiguïté avec laquelle sont notés les événements.
Les athlètes, eux, soutiennent l’initiative mais regrettent un manque d’information et de cohérence. Jacob Ingebrigtsen (champion norvégien) déplore « des meetings exemplaires à Oslo, et d’autres où règne le plastique à usage unique ». Femke Bol, elle, salue Zurich, mais fustige les écarts ailleurs en Europe. Tous demandent une homogénéisation des pratiques.
Enfin, les experts saluent l’effort mais alertent sur le risque de greenwashing. « Sans audits indépendants ni sanctions claires, la certification peut perdre sa crédibilité », avertit le climatologue Jean-Pascal van Ypersele. La chercheuse Madeleine Orr souligne un autre danger : laisser les petits événements sur le carreau, faute de moyens.
Conclusion : ABW, une révolution en marche, mais incomplète
En définitive, l’analyse du rapport annuel 2024 montre que les normes ABW constituent une initiative ambitieuse et porteuse, avec des fondations solides et une véritable volonté de transformer l’athlétisme en moteur de durabilité. Toutefois, leur déploiement se heurte encore à des obstacles majeurs : manque de moyens pour les petits organisateurs, difficulté à mesurer correctement les coûts environnementaux, inégalités entre événements et application trop théorique dans certains cas. Si l’intention est claire et sincère, la réussite de l’ABW dépendra de sa capacité à dépasser ces contraintes pratiques pour passer d’un cadre prometteur à une mise en œuvre réellement efficace et homogène.
Les normes Athletics for a Better World représentent une avancée majeure pour le sport mondial. En structurant la durabilité autour de critères concrets et en valorisant les bonnes pratiques, World Athletics montre la voie à suivre. Cependant, leur efficacité réelle dépendra de trois facteurs clés dans les années à venir : l’élargissement de l’adoption (aujourd’hui limitée à 20 % des événements), la simplification pour les petits organisateurs (sans les exclure du processus) et le passage des mots aux actes (sanctions, audits, transparence).
En 2027, quand ABW deviendra obligatoire, le monde de l’athlétisme aura un choix à faire : devenir le leader incontesté du sport durable ou rester un exemple parmi d’autres, avec des progrès inégaux et des promesses non tenues.